Actualités philosophiques, scientifiques et sociétales
Doutes sur la science
- Détails
- Écrit par : Patrick Juignet
Les platistes, les complotistes, les anti-vac, les trolls en tous genres, se déchainent pour asséner leurs absurdités et vilipender la science. Mais ils ne sont pas les seuls. La philosophie postmoderne a assimilé les sciences aux autres discours. Elle produirait des opinions sans spécificité et les controverses seraient de simples polémiques (des débats non contraints par les faits et par des règles de raisonnement). Sont venues s'ajouter des idéologies identitaires, anti-universalistes, mettant en cause la science et la rationalité.
La science fait le lien entre la volonté de savoir et une manière de connaître efficace. Cette association est devenue possible à partir du XVIIe siècle. Un processus collectif s’est engagé les siècles suivants, si bien que la science est sortie de la marginalité. Sa prise en charge sociale a permis d'avoir des institutions qui veillent sur les garanties exigibles pour la connaissance qui se prétend scientifique.
Les raisons du soutien politique à la science sont étrangères à celle-ci. Le développement scientifique et technique constitue le principal moteur économique et la clé de la puissance militaire des sociétés, depuis le XIXe siècle. C'est pourquoi les États et les grands acteurs économiques soutiennent son développement et cherchent à l'influencer. De la sorte, une partie de la recherche s'oriente vers la technoscience. Il se crée ainsi un domaine mixte dans lequel connaissances scientifiques et techniques sont étroitement imbriquées.
Technoscience et recherche appliquée aboutissent à des techniques exploitables industriellement qui ont des effets sociaux et environnementaux massifs. Ils ne vont pas toujours dans le sens du bien commun, car leur utilisation dépend de la rivalité entre États. Cela ne doit pas faire prendre de vue l’essentiel ! La science est d’abord un processus de connaissance de l’Univers tel qu’il est.
Voir l'article : Qu'est-ce que la science ?
L'émergence considérée comme concept ontologique
- Détails
- Écrit par : Patrick Juignet
La constitution de l’Univers peut être conçue en termes de niveaux d'organisation de complexité croissante. En accompagnement du concept d'organisation, une idée simple a été avancée : les diverses organisations procéderaient les unes des autres, elles s’engendreraient par complexification progressive (si les conditions le permettent). Le passage d’un type d’organisation à l’autre se ferait selon un processus qui a été appelé émergence.
Sur le plan ontologique, l'émergence conduit à supposer une dynamique entre les formes possibles de l'existence, ce qui explique la diversification de l'Univers. Avec ce concept, il est possible de concevoir un Univers dynamique et pluriel, ce qui s’oppose au monisme et au dualisme substantialistes qui cherchent à ramener l’existence à une ou deux substances homogènes et fixes.
La conséquence ontologique du concept d'émergence est importante. Elle suppose un Univers évolutif, mais aussi involutif. Si une complexification supérieure peut se former, elle peut aussi disparaitre ! Ce qui doit donner à réfléchir sur la fragilité du vivant et de ses formes les plus évoluées.
Voir l'article : L'émergence concept ontologique ?
Philosophie naturelle en bande dessinée
- Détails
- Écrit par : Patrick Juignet
Non la science ne commence pas vraiment dans la Grèce antique, comme il est dit dans la préface du livre. Les auteurs de manière bien plus avisée nous apprennent qu'il s'agit alors de philosophie naturelle (p. 24) car science et philosophie ne sont pas encore distinctes. Cependant, la rationalité et l'esprit critique sont devenus possibles dans les cités démocratiques et, grâce à cette évolution, la philosophie naturelle s'est différenciée des mythologies et des religions. La science, au sens actuel du terme, ne viendra que bien plus tard, au tome 4, explique l'auteur au dessinateur, et donc au lecteur.
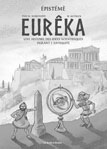 Cet humour à trois (entre le lecteur, le narrateur et le dessinateur) est présent tout au long de l'ouvrage. Pascal Marchand et Jean-Benoit Meybeck chacun dans son rôle, façon Don Quichotte et Sancho Panza, jonglent entre le passé et le présent, entre l'apéro et l'apeiron, et nous entrainent avec eux dans une course folle, mais très sérieuse et bien documentée. Projeté dans l'aventure par la confrontation brutale à nos trolls contemporains, nous voilà partis pour un voyage allègre, à la fois temporel et graphique, une aventure un peu déjantée et passionnante. Ce premier tome est consacré aux débuts en Grèce de la philosophie naturelle, c'est-à-dire aux « théories à l'origine (ou non) des sciences contemporaines ! » Avec la série Épistémè, grâce aux personnages et aux anecdotes, la science prend chair ! s'exclame Pascal "Quichotte". Elle prend cher ! rétorque ironiquement Jean-Benoit "Panza" qui trouve bizarre les savants rencontrés. Nous conclurons que le livre est plutôt bon marché : 22 €
Cet humour à trois (entre le lecteur, le narrateur et le dessinateur) est présent tout au long de l'ouvrage. Pascal Marchand et Jean-Benoit Meybeck chacun dans son rôle, façon Don Quichotte et Sancho Panza, jonglent entre le passé et le présent, entre l'apéro et l'apeiron, et nous entrainent avec eux dans une course folle, mais très sérieuse et bien documentée. Projeté dans l'aventure par la confrontation brutale à nos trolls contemporains, nous voilà partis pour un voyage allègre, à la fois temporel et graphique, une aventure un peu déjantée et passionnante. Ce premier tome est consacré aux débuts en Grèce de la philosophie naturelle, c'est-à-dire aux « théories à l'origine (ou non) des sciences contemporaines ! » Avec la série Épistémè, grâce aux personnages et aux anecdotes, la science prend chair ! s'exclame Pascal "Quichotte". Elle prend cher ! rétorque ironiquement Jean-Benoit "Panza" qui trouve bizarre les savants rencontrés. Nous conclurons que le livre est plutôt bon marché : 22 €
Marchand P. Meybeck B., Eurêka Une histoire de idées scientifiques durant l'Antiquité, Paris, La Boite à Bulles, 2023.
La nature n’est pas l'environnement
- Détails
- Écrit par : Patrick Juignet
Un certain nombre de présupposés empêchent de penser convenablement la relation entre les humains et leur environnement immédiat (terrestre). En tout premier lieu l’idée de « Nature » qui est chargée d'un poids imaginaire et métaphysique, et qui reste lourde d'une longue tradition l'opposant à la culture. Le terme est terriblement polysémique (voir la définition). Dans le débat public, ce que l'on nomme Nature correspond souvent à l'environnement terrestre et principalement à la biosphère. Mais il n'est pas perçu et analysé comme tel. L'environnement est assimilé à la Nature, entité qui donne lieu à toutes sortes d'interprétations, dont certaines sont fantaisistes, et à des sentiments variés qui vont de l'amour à l'hostilité en passant par l'indifférence.
