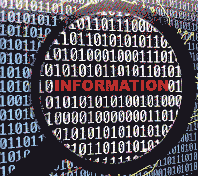
De nombreuses questions se posent face à l'utilisation massive de l'intelligence artificielle. En particulier, celle d'une perte d’autonomie dans les décisions qui peut aller jusqu’à un assujettissement, une servitude plus ou moins volontaire. Concernant l'IA générative, les documents générés dépendent étroitement des données, de leur authenticité et de leur fiabilité — sans même évoquer leur statut juridique et leur rapport à la réalité objective. Quelles garanties avons-nous à ce sujet ?
L’enthousiasme officiel ne vient-il pas d'un biais de jugement, issu du lobbying des trusts de la tech ? Les promesses de l’IA ne s’apparente-t-elle pas à un « dumping intellectuel » cachant une volonté de rendre captifs les utilisateurs de l'IA ? Le prestige d’une force « intellectuelle » surhumaine ne conduit-il pas à une perte d’autonomie qui peut aller jusqu’à une forme de servitude volontaire. Enfin, les nouvelles formes de gouvernementalité appuyées sur l’IA et symbolisées par la mission confiée à Elon Musk pour réduire l’État fédéral aux USA, comme par l’application du programme chinois de contrôle social intégral, sont-elles compatibles avec la démocratie et l’État de droit ?
Le lancement à l’automne 2022 des premiers générateurs de textes et d’images a suscité un engouement inouï et toujours croissant. L’intelligence artificielle a envahi le discours public où s’opposent technophobes et technophiles. Sans entrer dans ce débat biaisé qui reporte sur la technique la responsabilité de ses usages, cette étude souligne la rupture anthropologique qu’introduit la génération automatique de textes et d’images. Elle touche tant les sciences que les arts, et affecte l’ensemble de la vie sociale. Mais elle peut aussi affecter la vie personnelle, et l’auteur se permet de démentir avec le sourire les annonces de sa mort que multiplie le plus populaire des systèmes d’IA
Pour Jean Lassègue et Giuseppe Longo le « numérique » est devenu un mot passe-partout dont il est difficile de préciser la signification tant sont nombreux les effets d’annonce, que ce soit pour célébrer les avancées surhumaines qu’il rend ou rendrait possible que pour se prémunir contre ses dangers. Pour éviter d’en rester à cette ambivalence qui varie au gré des investissements financiers et empêche de penser, il faut commencer par revenir aux fondements épistémologiques du numérique, car c’est ce qui permet de comprendre ses conséquences, qu’elles soient théoriques ou sociales. C’est pourquoi ce livre se propose de clarifier la notion de numérique à partir de trois concepts qui en constituent le cœur : ceux d’écriture, de calcul et de machine. C’est par eux que le numérique révolutionne nos capacités d’expression, d’exploration et d’action, en rendant possible de déléguer celles-ci à des machines au moyen du calcul. Cette révolution de l’écriture numérique provoque un sentiment d’intense dépossession nourrissant toutes sortes de fantasmes, plus souvent alimentées par des intérêts financiers que par le bien commun. Il est temps de rouvrir le dossier épistémologique du numérique pour contribuer à en faire un outil d’émancipation et non d’assujettissement.
¤¤¤