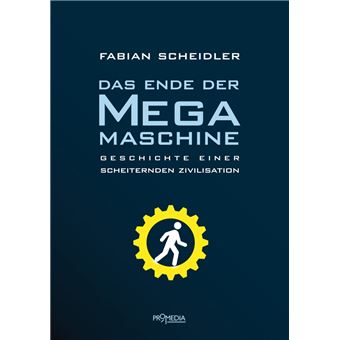 Le livre La fin de la mégamachine (Das ende der Megamaschine) retrace les origines et le développement d’un système à la fois technique, économique et politique que Fabian Scheidler appelle la « mégamachine ».
Le livre La fin de la mégamachine (Das ende der Megamaschine) retrace les origines et le développement d’un système à la fois technique, économique et politique que Fabian Scheidler appelle la « mégamachine ».
Il propose un grand récit historique et anthropologique éclairant. Le sous-titre de l'édition allemande Histoire d'une civilisation défaillante est bien meilleur que celui à connotation apocalyptique de l'édition française, de même que l'illustration avec un rouage. C'est pourquoi nous avons montré la couverture originale.
L'auteur nous propose une histoire de l'envers du décor, qui est aussi l'enfer du décor (guerres, massacres, esclavagisme, famines, prolétarisation). C'est le récit de ce que l'histoire officielle, centrée sur les puissants et leur ascension politique, met soigneusement de côté : la misère et la mort pour une grande partie de la population.
Il est triste de constater que l'histoire qui se prétend sérieuse, voire scientifique, soit si partiale et partielle. « les historiens racontent le plus souvent l'histoire du point de vue des vainqueurs » (p. 79). Mais aussi seulement du point de vue des puissants. L'histoire de la majorité de la population est manquante. Les souffrances occasionnées par la violence, l'asservissement, les guerres, n'apparaissent pas dans les annales et donc peu dans l'histoire.
Les systèmes techno-économico-industriels sont mus par une dynamique en raison de la concurrence et de la course à la puissance. Pour les désigner, le terme de « mégamachine », proposé par l’historien Lewis Mumford et repris par Fabian Scheidler est intéressant. Ce concept métaphorique désigne le système à la fois technique, économique et politique qui structure la plupart des sociétés industrielles. À l’origine de la « mégamachine », l’auteur place la volonté de domination et la violence organisée. Le mot à une force d’évocation intéressante. Il renvoie à deux aspects du social :
– d’une part, le développement des sociétés selon une loi d’extension difficilement répressible.
– d’autre part l’omniprésence des artefacts (machines en tous genres) dans nos sociétés contemporaines et leur croissance continue.
À l’origine de la mégamachine, l’auteur place la volonté de domination. Cette volonté porte sur l’Homme, sur la matière, et plus généralement sur la nature. On la trouve depuis l’Antiquité jusqu'à la période moderne. Elle s’appuie sur le pouvoir physique fondé sur de la violence, le pouvoir socio-économique qui enrôle et dompte (en particulier au moyen de la dette) et le pouvoir idéologique qui légitime l’asservissement. Ces contraintes engendrent une quatrième tyrannie, la tyrannie de la pensée linéaire, c’est-à-dire l’idée d’une relation entre une cause et un effet unique et prévisible, à la manière d’un ordre donné. Ces quatre tyrannies forment les briques de base de la mégamachine.
Au Vᵉ siècle la Cité d'Athènes, traditionnellement présentée comme le berceau de la démocratie, a mis en route le principal rouage de la mégamachine. Il s'y est constitué un système social associant l'argent et la puissance militaire, l'ensemble reposant sur un esclavage de vaste ampleur. Les esclaves travaillant dans les mines d'argent produisaient la monnaie qui permettait de payer une armée démesurée qui permettait des conquêtes, qui rapportaient des esclaves et ainsi de suite. La circulation monétaire apportée par la solde des mercenaires repris par l'impôt a détruit l'économie de substance et a contraint les paysans à fournir les marchés. L'appareil militaire demandait une industrie pour les armes, les équipements, le transport (en particulier une flotte gigantesque de 200 navires de guerre). La macédoine a fait de même un siècle plus tard dans de plus grandes proportions. La mégamachine était déjà en route.
Ce sont là les rouages nécessaires de la mégamachine : armée + monnaie + industrie + asservissement des populations. L'esclavage a été remplacé par le salariat dont les conditions se sont améliorées en Occident, mais pas en Chine, ni dans les mines d'uranium en Afrique. Cette amélioration du salariat vient de ce que l'expansion de l'industrie demande des consommateurs pour se perpétrer et de systèmes politiques admettant des contre-pouvoirs. Entre temps le système financier est devenu capitalistique et les entreprises sont devenues des sociétés par actions dont l'unique finalité est l'enrichissement des actionnaires. Ce sont des personnes morales ou juridiques sans aucun devoir moral. Elles sont seulement à respecter les lois qui les régissent et leur sont largement favorables. Le système de l'endettement s'est généralisé et provoque un asservissement des endettés. Les États sont devenus des monstres (déjà identifié comme « Léviathan » par Thomas Hobbes en 1651) avec des armées gigantesques et des administrations énormes.
De nos jours, ce système produit une accumulation de marchandises au prix de la destruction de l’environnement. Cette accumulation de biens a donné les sociétés dites de consommation et de loisirs, qui plaisent à une bonne partie de la population. Il ne faut pas oublier l'envers du décor, comme le rappelle Fabian Scheidler : des richesses inouïes côtoient la grande pauvreté, des salariés accablés de travail sont face à des désœuvrés misérables. La gigantesque machinerie économique entraîne hommes, matières et animaux dans une course productiviste sans finalité établie et aux effets destructeurs. Mais, pour l'instant, en ce début de XXIe siècle, c'est le déni collectif qui prévaut.
Le livre de Fabian Scheidler montre comment ce ne sont pas la quête du savoir, l’amour du prochain, la joie de la découverte qui façonnent la trajectoire historique que nous suivons, mais la recherche du profit, l’attrait du pouvoir, la volonté d’asservir. Il fait ressortir la barbarie de la modernité, pour les humains comme pour la nature. La mégamachine semble tantôt construite selon un plan, tantôt apparaît comme la propriété émergente du réseau des interactions en cours. Le caractère implacable de son développement absurde est bien mis en évidence. L’auteur met en évidence la puissance d’expansion de la mégamachine, sa capacité à se réinventer et à persévérer, quelles que soient les crises qu’elle traverse.
Schneider dénonce un système fondé sur le pillage qui s’est diffusé dans le monde entier. Ce système est masqué par le mythe de la civilisation occidentale qui prône le progrès, la paix, et valorise le savoir, la culture et la liberté. Cette analyse post-moderne des valeurs humanistes comme masque de la barbarie est contestable. Qu'elles aient été utilisées de cette manière est vrai, mais c'est un détournement. Leur transformation en paravent idéologique, tout comme le sont les religions, doit être dénoncée. L'humanisme et le libéralisme politique sont des antidotes à la politique qui prônent la force contre le droit, la tyrannie contre la démocratie, l’asservissement contre la liberté. Ce sont des doctrines qui peuvent servir, quoique modestement, car la philosophie a peu de poids face à la propagande idéologique véhiculée par les médias.
Scheidler Fabian, La fin de la Mégamachine, Sur les traces d’une civilisation en voie d’effondrement, Paris, Éditions du Seuil, 2020.
Mots clés : histoire, économie, politique, civilisation, anthropologie, écologie.