Actualités philosophiques, scientifiques et sociétales
Les mathématiques ont un sens
- Détails
- Écrit par : Patrick Juignet
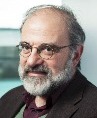
Mathématicien, Giuseppe Longo a consacré une grande partie de ses travaux à l’étude des relations entre mathématiques, informatique et physique, et à l’élaboration de concepts théoriques applicables à la biologie.
Il note que les mathématiques sont abstraites, symboliques, rigoureuses, mais que les philosophies formalistes ont réduit ces trois notions différentes et difficiles à une seule : le formalisme. Les mathématiques seraient alors un calcul sur des signes sans signification. Cette réduction a eu des conséquences remarquables. - D'une part, l'abstraction et la rigueur des formalismes ont permis l'invention d'une machine logique de calcul (la machine de Turing) qui a contribué à révolutionner le monde. - D'autre part, la superposition de l'intelligible mathématique sur le mécanisable a contribué à une vision scientiste du monde dépourvue de sens, mais aussi de rigueur.
Elle a notamment façonné une vision mécaniste du vivant, qui contribue à la perturbation de l'écosystème et aux dérives d'une biologie moléculaire dominante aux principes faux ou vagues et aux lourdes conséquences. À la frontière entre mathématiques, logique, informatique et biologie, Giuseppe Longo défend l'importance du sens dans la pratique des mathématiques.
Synchronisation des neurones et mathématiques
- Détails
- Écrit par : Patrick Juignet
Constitué d’environ 86 milliards de neurones connectés entre eux par des synapses 10000 fois plus nombreuses, le cerveau humain commande le corps à travers une symphonie électrochimique permanente. Mais comment les neurones individuels communiquent-ils entre eux pour apporter une réponse globale adéquate ? Pour répondre à cette question aujourd’hui, il semble nécessaire d’allier les recherches de neuroscientifiques, de physiciens et de mathématiciens.
Des recherches ont mis en évidence une synchronisation en temps réel de l’activité neuronale de certaines zones du cerveau, ainsi que leur correspondance en termes de calcul vectoriel. Des modèles mathématiques constitués de réseaux d’équations différentielles ordinaires sont utilisés pour modéliser l’activité neuronale.
Voir : La symphonie des neurones ou les mathématiques du cerveau
Pour une reconstruction philosophique et culturelle
- Détails
- Écrit par : Patrick Juignet
Un projet de reconstruction intellectuelle, en opposition à la déconstruction en cours depuis maintenant un demi-siècle, a été lancé. Pour François Rastier, la déconstruction et le postmodernisme ont introduit une coupure dans l’histoire humaine. Ces doctrines récusent le projet historique et comparatif des sciences de la culture, comme celui des sciences en général, en relativisant et délégitimant l'idée de vérité. Elles fondent ainsi le régime de la post-vérité dans lequel tout point de vue peut se prétendre vrai. Il importe maintenant, selon, lui de formuler le programme d’une reconstruction.
Un constat accablant
François Rastier écrit :
« Un mouvement informel et informe diffuse une conception délétère du monde, où la science n’a pas plus de valeur qu’une croyance ou une religion. Pour certains, la Terre reste plate, les vaccins ne servent à rien d’autre qu’à nous contrôler, les masques nous bâillonnent… D’autres contestent la « domination » des européens en Europe au motif d’un péché originel accablant le « patriarcat blanc hétérosexuel ». Un peu partout, des groupes identitaires fondés sur le sexe, la couleur de peau, la nationalité, se sont constitués et multiplient les divisions, comme s’ils préparaient la guerre de tous contre tous ».
Lire la suite : Pour une reconstruction philosophique et culturelle
Changement climatique
- Détails
- Écrit par : Patrick Juignet
En 2017 la revue Bio Science a alerté sur la dégradation de l’environnement. Cette alerte se fondait sur neuf indicateurs mondiaux, dont l'évolution a été suivie de 1960 à 2016. Les résultats sont les suivants :
Le point positif est que le taux d'ozone stratosphérique a diminué grâce au protocole de Montréal (1987). Pour le reste :
- Les ressources en eau douce par habitant ont été divisées de moitié par rapport à 1960.
- Les limites d'une pêche soutenable sont dépassées depuis 1992.
- Les zones maritimes mortes ont augmenté en nombre.
- De grandes superficies forestières ont été perdues entre 1990 et 2015.
- Les espèces vertébrées ont diminué de 58% entre 1970 et 2012.
- Après une courte stabilisation, une nouvelle hausse des émissions de CO₂ a lieu.
- Nous vivons les années les plus chaudes parmi celles connues.
- Les humains pourraient être environ 11 milliards en 2100.
Depuis 2017, tout s’est aggravé sauf le taux d'ozone qui reste bas. Bien que cela soit maintenant connu et reconnu, les actions pour endiguer la dégradation de l’environnement sont très insuffisantes. La raison en est la puissance de la « mégamachine » évoquée dans l’article précédent. L’impossibilité de la freiner conduit à une modification de l’écosystème, dont on voit bien qu’il va provoquer des bouleversements dans la biosphère et dans le climat.