Actualités philosophiques, scientifiques et sociétales
L'émergence considérée comme concept ontologique
- Détails
- Écrit par : Patrick Juignet
- Catégorie : Actualités philosophiques, scientifiques et sociétales
La constitution de l’Univers peut être conçue en termes de niveaux d'organisation de complexité croissante. En accompagnement du concept d'organisation, une idée simple a été avancée : les diverses organisations procéderaient les unes des autres, elles s’engendreraient par complexification progressive (si les conditions le permettent). Le passage d’un type d’organisation à l’autre se ferait selon un processus qui a été appelé émergence.
Sur le plan ontologique, l'émergence conduit à supposer une dynamique entre les formes possibles de l'existence, ce qui explique la diversification de l'Univers. Avec ce concept, il est possible de concevoir un Univers dynamique et pluriel, ce qui s’oppose au monisme et au dualisme substantialistes qui cherchent à ramener l’existence à une ou deux substances homogènes et fixes.
La conséquence ontologique du concept d'émergence est importante. Elle suppose un Univers évolutif, mais aussi involutif. Si une complexification supérieure peut se former, elle peut aussi disparaitre ! Ce qui doit donner à réfléchir sur la fragilité du vivant et de ses formes les plus évoluées.
Voir l'article : L'émergence concept ontologique ?
Philosophie naturelle en bande dessinée
- Détails
- Écrit par : Patrick Juignet
- Catégorie : Actualités philosophiques, scientifiques et sociétales
Non la science ne commence pas vraiment dans la Grèce antique, comme il est dit dans la préface du livre. Les auteurs de manière bien plus avisée nous apprennent qu'il s'agit alors de philosophie naturelle (p. 24) car science et philosophie ne sont pas encore distinctes. Cependant, la rationalité et l'esprit critique sont devenus possibles dans les cités démocratiques et, grâce à cette évolution, la philosophie naturelle s'est différenciée des mythologies et des religions. La science, au sens actuel du terme, ne viendra que bien plus tard, au tome 4, explique l'auteur au dessinateur, et donc au lecteur.
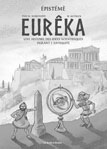 Cet humour à trois (entre le lecteur, le narrateur et le dessinateur) est présent tout au long de l'ouvrage. Pascal Marchand et Jean-Benoit Meybeck chacun dans son rôle, façon Don Quichotte et Sancho Panza, jonglent entre le passé et le présent, entre l'apéro et l'apeiron, et nous entrainent avec eux dans une course folle, mais très sérieuse et bien documentée. Projeté dans l'aventure par la confrontation brutale à nos trolls contemporains, nous voilà partis pour un voyage allègre, à la fois temporel et graphique, une aventure un peu déjantée et passionnante. Ce premier tome est consacré aux débuts en Grèce de la philosophie naturelle, c'est-à-dire aux « théories à l'origine (ou non) des sciences contemporaines ! » Avec la série Épistémè, grâce aux personnages et aux anecdotes, la science prend chair ! s'exclame Pascal "Quichotte". Elle prend cher ! rétorque ironiquement Jean-Benoit "Panza" qui trouve bizarre les savants rencontrés. Nous conclurons que le livre est plutôt bon marché : 22 €
Cet humour à trois (entre le lecteur, le narrateur et le dessinateur) est présent tout au long de l'ouvrage. Pascal Marchand et Jean-Benoit Meybeck chacun dans son rôle, façon Don Quichotte et Sancho Panza, jonglent entre le passé et le présent, entre l'apéro et l'apeiron, et nous entrainent avec eux dans une course folle, mais très sérieuse et bien documentée. Projeté dans l'aventure par la confrontation brutale à nos trolls contemporains, nous voilà partis pour un voyage allègre, à la fois temporel et graphique, une aventure un peu déjantée et passionnante. Ce premier tome est consacré aux débuts en Grèce de la philosophie naturelle, c'est-à-dire aux « théories à l'origine (ou non) des sciences contemporaines ! » Avec la série Épistémè, grâce aux personnages et aux anecdotes, la science prend chair ! s'exclame Pascal "Quichotte". Elle prend cher ! rétorque ironiquement Jean-Benoit "Panza" qui trouve bizarre les savants rencontrés. Nous conclurons que le livre est plutôt bon marché : 22 €
Marchand P. Meybeck B., Eurêka Une histoire de idées scientifiques durant l'Antiquité, Paris, La Boite à Bulles, 2023.
La nature n’est pas l'environnement
- Détails
- Écrit par : Patrick Juignet
- Catégorie : Actualités philosophiques, scientifiques et sociétales
Un certain nombre de présupposés empêchent de penser convenablement la relation entre les humains et leur environnement immédiat (terrestre). En tout premier lieu l’idée de « Nature » qui est chargée d'un poids imaginaire et métaphysique, et qui reste lourde d'une longue tradition l'opposant à la culture. Le terme est terriblement polysémique (voir la définition). Dans le débat public, ce que l'on nomme Nature correspond souvent à l'environnement terrestre et principalement à la biosphère. Mais il n'est pas perçu et analysé comme tel. L'environnement est assimilé à la Nature, entité qui donne lieu à toutes sortes d'interprétations, dont certaines sont fantaisistes, et à des sentiments variés qui vont de l'amour à l'hostilité en passant par l'indifférence.

Énaction et linguistique
- Détails
- Écrit par : Patrick Juignet
- Catégorie : Actualités philosophiques, scientifiques et sociétales
Rapprocher énaction et linguistique a quelque chose de paradoxal. Cela a été tenté par Maturana (1978), Maturana et Varela (1994) et a ensuite fait l’objet de reprises dans un certain nombre de travaux en linguistique et en sémiotique (Linell, 2009), (Cowley, 2011), (Thibault 2011), (Kravchenko, 2012), (Raimondi, 2014), (Bottineau, 2012, 2017), Love (2007, 2017), au travers de la notion de languaging.
Signifiant initialement un type de coordination comportementale récursive, le terme anglophone languaging en est venu à désigner plus génériquement l’activité de langage, par opposition aux langues historiques qui en sont le produit. Dans ce cadre la parole n’est plus conçue comme la mise en œuvre d’un système abstrait qui lui préexisterait, mais comme une activité au sein de laquelle émergent des régularités métastables. La notion permet de lier plusieurs principes caractéristiques de l’énaction, notamment l'interactionnisme, la praxéologie et l'émergentisme.
La notion de languaging est un point d’entrée pour discuter des liens entre énaction et linguistique. Le couplage des comportements serait la base de la communication. Les structures cognitives émergeraient des schèmes sensori-moteurs et celles de la communication aussi. Il s'organiserait un couplage interactif entre les interlocuteurs une coordination des interactions. À un degré de plus, une coordination des coordinations donnerait le languaging.
Francisco Varela et suiveurs se prononcent contre l'idée de représentation, qui selon eux correspondrait à la copie d'un élément présent dans l'environnement. Il laissent aussi de côté la référence à une langue préexistante. Aucune distinction n'est faite entre indice, symbole et signe. Sémantique et syntaxe sont absentes. Nulle part, il n'est question de sens, de signification en encore moins de concepts ou de pensée. Nous sommes dans une approche comportementale qui peut s'appliquer aux animaux, mais dont on ne voit pas comment elle pourrait rendre compte de la communication humaine dans ses formes un peu élaborées.